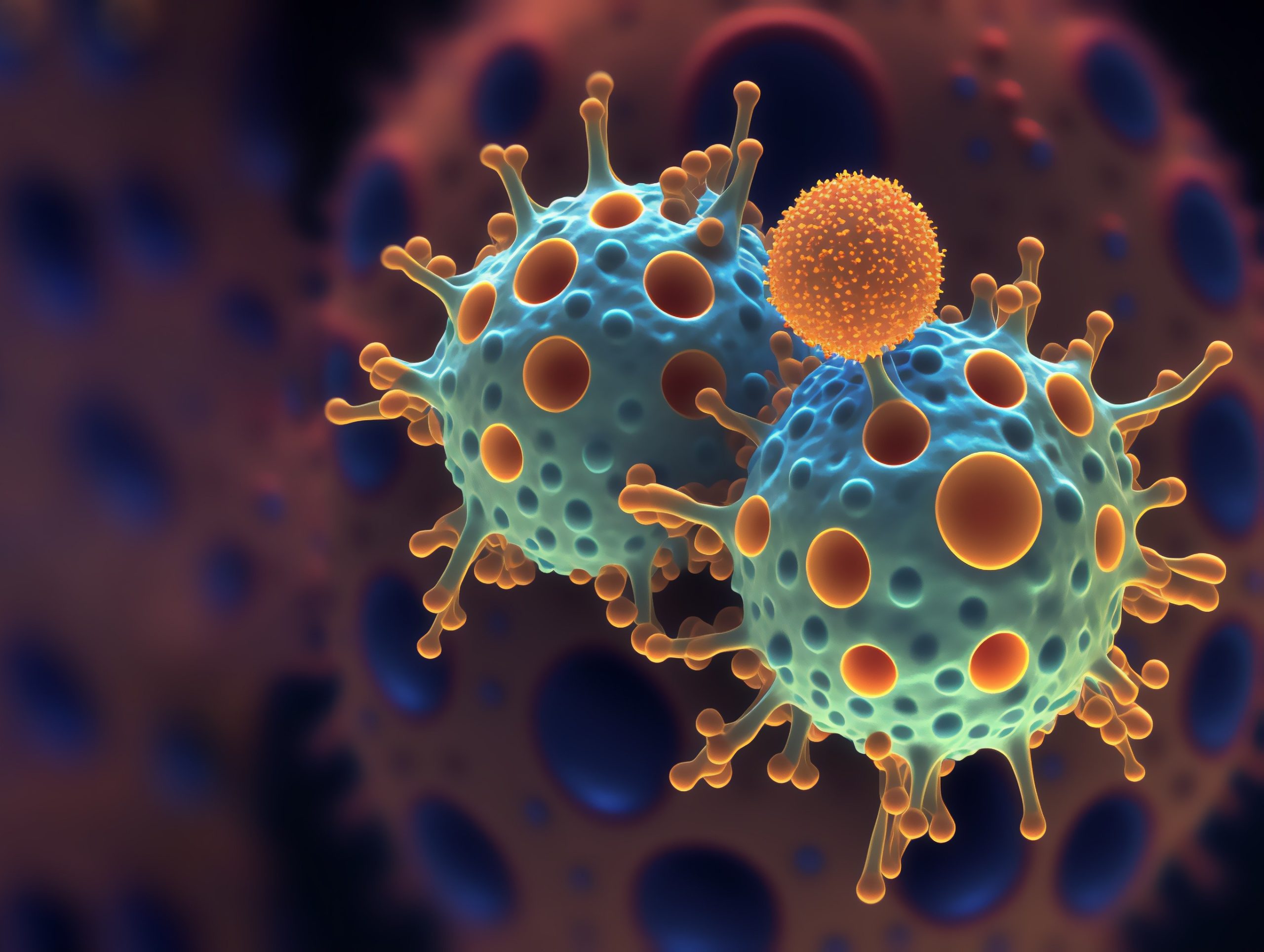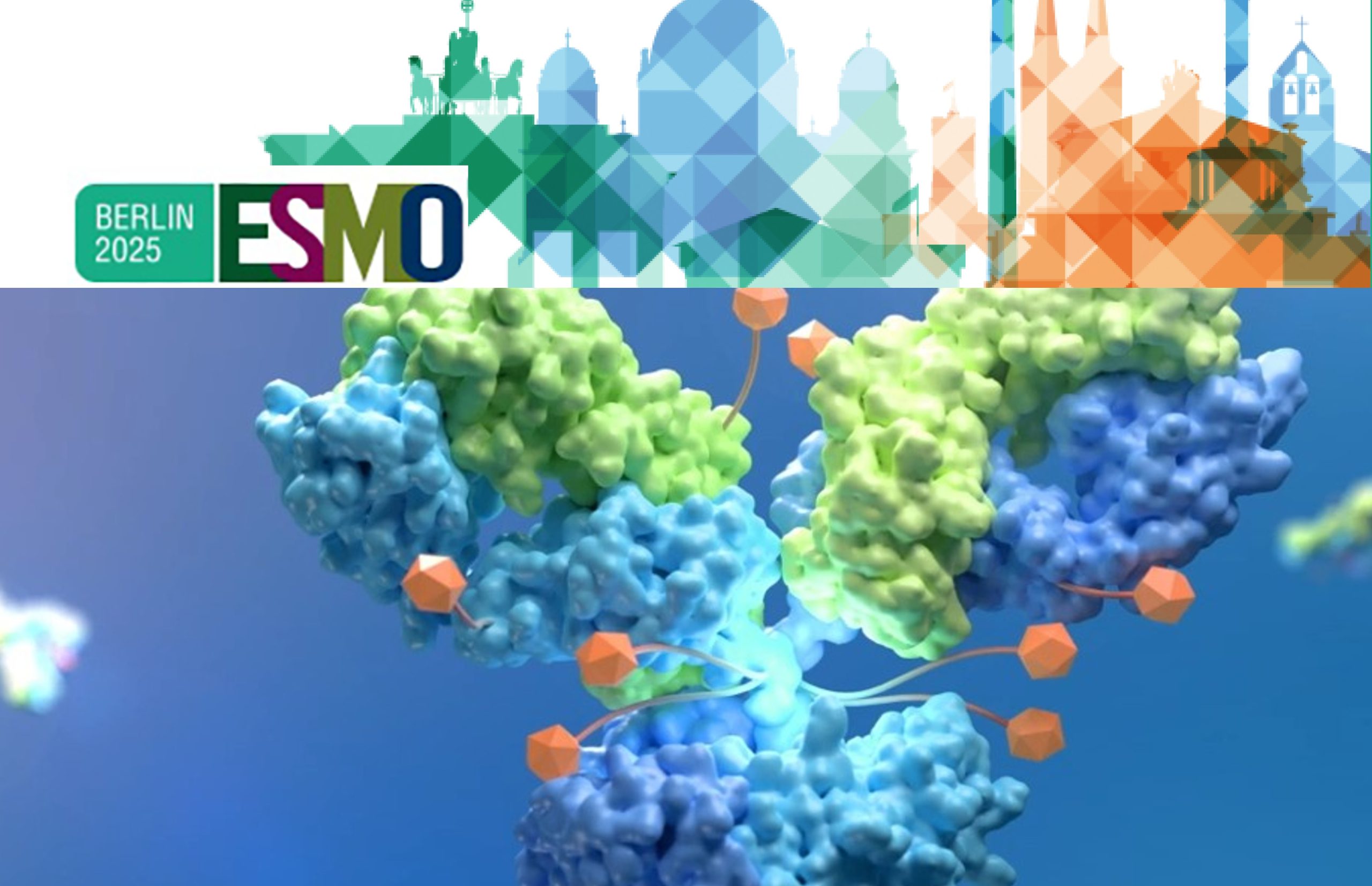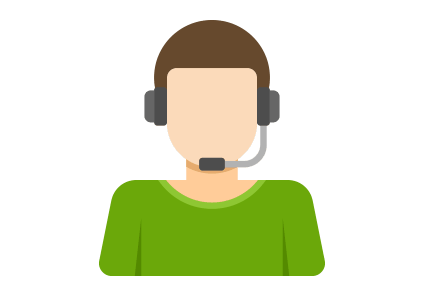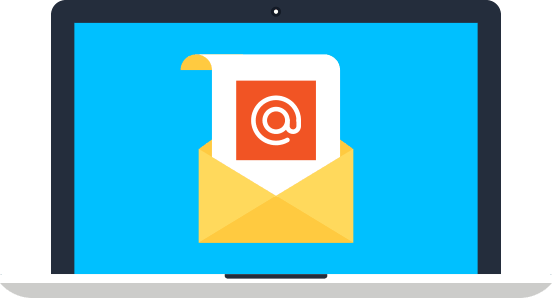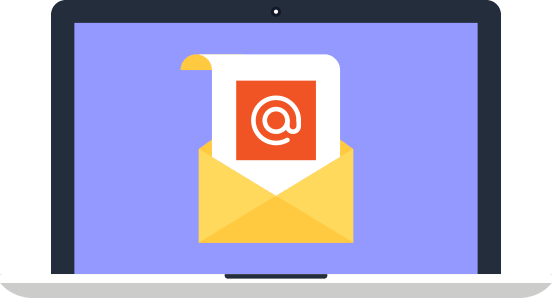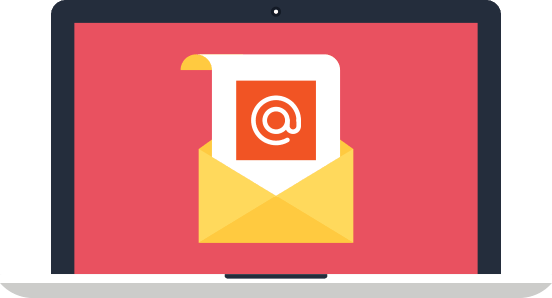Environnement et cancer : un impact sous-estimé

L’académie de chirurgie alerte sur l’impact des facteurs environnementaux sur l’incidence des cancers, un enjeu de santé public sous-estimé, mais sur lequel l’apport de preuves définitives est particulièrement complexe. Tous les outils de recherche doivent être mobilisés.
La France est n°1 mondiale… en termes d’incidence du cancer du sein. Ce constat « préoccupant » a été rappelé par la Pr Carole Mathelin, cheffe du service de chirurgie de l’Institut de cancérologie de Strasbourg, qui préside depuis janvier l’Académie nationale de chirurgie, en introduction d’un point presse organisé le 9 avril. L’Académie consacrait ce jour-là une séance spéciale aux enjeux de la recherche en santé environnementale. Si des facteurs de risque comportementaux sont déjà bien connus et avérés, comme le tabagisme, la consommation d’alcool, l’obésité et la sédentarité, la proportion de 10 % de cancers attribuable aux expositions professionnelles et à l’environnement est « probablement sous-estimée », indique la Pr Béatrice Fervers, oncologue, directrice du Département Prévention Cancer Environnement du Centre Léon Bérard à Lyon. « Pour environ la moitié des femmes souffrant d’un cancer du sein, on ne peut pas identifier de cause évidente », ajoute la Dr Meriem Koual, chirurgienne gynécologue spécialisée en cancérologie sénologique et gynécologique à l’Hôpital européen Georges Pompidou et chercheuse à l’Université Paris Cité, coordinatrice de l’évènement.
Des polluants dosés dans les tissus tumoraux

Un « faisceau d’indices » conforte en effet le poids des facteurs environnementaux. Carole Mathelin cite ainsi les résultats de diverses études épidémiologiques, montrant que des femmes migrantes, sans changer forcément leurs habitudes alimentaires, acquièrent au bout d’une quinzaine d’années le même niveau de risque de cancer du sein que les femmes autochtones ; ou encore que des lieux de vie différents impactent le risque de cancer de jumelles ayant le même patrimoine génétique. Un surrisque a aussi été observé chez des agricultrices utilisant des produits phytosanitaires.
Pour tenter d’apporter des preuves plus concrètes, « nous avons en région Grand-Est mené une expérimentation auprès de femmes opérées pour un cancer du sein. » Avec leur consentement, 578 perturbateurs endocriniens, 4 PFAS et 30 métaux ont été dosés dans des échantillons de tissus tumoraux opérés, « un processus très compliqué à mettre en œuvre ». Les résultats montrent le « niveau d’intoxication » des cellules des patientes. « Quatre perturbateurs endocriniens nous paraissent dangereux ; les quatre PFAS dosés, qui n’ont pas le même site de fixation tumorale ni le même mode d’action, peuvent tous être incriminés. Six métaux nous paraissent également présenter un danger », rapporte Carole Mathelin. Un article présentant ces premières données « vient d’être refusé par une revue scientifique américaine… mais je vais le resoumettre ! Ce sont des études prospectives intéressantes qui nous donnent des pistes pour des actions de prévention primaire. » Les chirurgiens opérant les cancers du pancréas, également en augmentation notamment chez les jeunes, ont aussi été incités à effectuer ces mêmes dosages.
Elargir les connaissances pour agir en prévention

L’effet « cocktail » a son importance. « On a montré que chez certaines femmes exposées fortement à un mélange d’agents – particules fines, dioxydes d’azote, polychlorobiphényles (PCBs) – que l’on rencontre dans des villes comme Lyon ou Paris, le niveau de risque de cancer du sein peut être augmenté jusqu’à 50 %, avec des effets synergiques de certains polluants », rapporte la Pr Fervers. Cette synergie rend d’autant plus complexe la démonstration de l’effet délétère d’un composant particulier. Sans avoir de réponse définitive, « nous avons déjà des faisceaux d’arguments. Certains mécanismes moléculaires précis sont eux déjà bien identifiés, par exemple pour expliquer comment l’exposition à certains polluants induit une résistance aux traitements anticancéreux », note Meriem Koual.
Mais sans attendre l’arrivée de preuves décisives, certaines actions de prévention peuvent déjà être mises en place. La Pr Carole Mathelin cite par exemple la distribution à Strasbourg de paniers de légumes bio aux femmes enceintes durant leur grossesse, considérée comme une période de « vulnérabilité » pour les femmes. Le caractère très lipophile de certains polluants (qui se concentrent particulièrement dans les graisses) étant lui aussi démontré, une vigilance particulière est requise en cas de perte de poids rapide. La prévention de l’obésité fera partie des stratégies clés.
Les recherches se développent aussi sur l’exposome, « un modèle très intéressant pour comprendre, agir et orienter la prévention », estime Béatrice Fervers, même si elle reconnaît qu’il est encore « un peu présomptueux » de vouloir caractériser la totalité de l’exposome d’une personne. « L’IA peut nous aider, notamment sur l’analyse des données environnementales ouvertes », espère Meriem Koual, citant les études en cours pour lier l’exposition à des polluants atmosphériques au risque de cancer. « Il nous faudra être très modestes, au vu du nombre de paramètres qui interviennent, insiste Carole Mathelin. Mais je crois que nous aboutirons tout de même, assez prochainement, à quelques éléments de réflexion en santé publique, avec quelques grands produits qu’il faudra éviter. »
Julie Wierzbicki