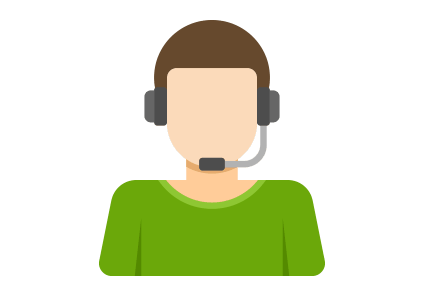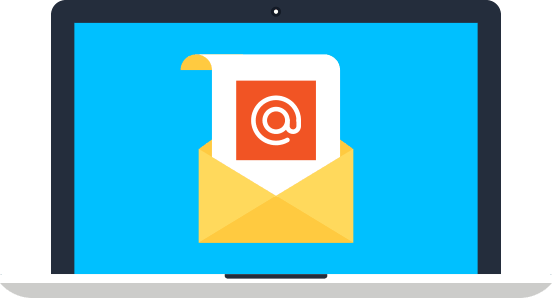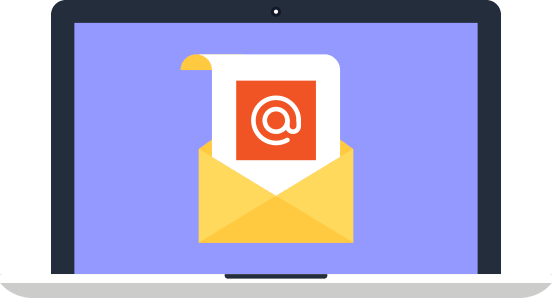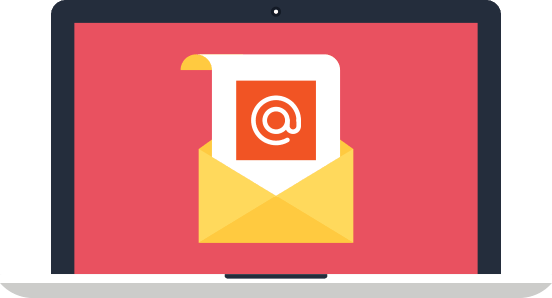Prévention : le ”aller vers” est l’affaire de tous

A l’occasion des Assises de la Prévention, plusieurs entrepreneurs spécialisés dans le domaine ont illustré la nécessité d’élargir le champ des programmes de prévention, en particulier du côté des entreprises.
Si les acteurs de santé sont essentiels pour développer une réelle culture de la prévention en santé, le défi va bien au-delà du seul périmètre des soignants. Le 13 mai dernier, les Assises des Préventions en Santé, organisées à PariSanté Campus par l’agence Aromates, en ont témoigné tout au long de la journée : la promotion de la prévention est l’affaire de tous. Une table ronde réunissant des entrepreneurs spécialisés dans « l’industrialisation » des programmes de prévention l’a démontré avec force : le monde du travail a un rôle majeur à jouer en faveur de la bonne santé des salariés français. Fondatrice et dirigeante de la société Kor, Sophie Agosta l’exprime d’emblée. « La CNAM, en tant qu’assureur public de santé en situation de monopole sur la part des dépenses remboursées, a bien entendu une position-clé pour animer et déployer les outils de prévention au service de tous, indique-t-elle. Cependant, l’assurance-maladie ne saurait être le seul acteur à porter les messages et à encourager l’engagement de la population dans la gestion de sa santé au quotidien. Déjà très investis dans ce domaine, les assureurs complémentaires doivent aller plus loin pour faciliter l’accès de leurs adhérents à une information fiable et certifiée, à des programmes de dépistage et de vaccination, à des bilans de prévention permettant de stratifier les risques de santé. »
Les DRH s’impliquent
Ancien DRH, notamment dans la presse, Sébastien Abgrall est directeur général de Pôle Santé Bergère, un centre de soins parisien qui s’implique également dans la réalisation de bilans de santé personnalisés, pour les particuliers mais également pour les entreprises. « Notre offre s’adresse notamment aux DRH, car la protection de la santé des salariés devient un enjeu-clé des politiques RSE, estime-t-il. C’est un levier favorable pour rendre une marque plus positive. C’est également un défi de compétitivité, à l’heure où il faut se battre pour attirer les talents. C’est, enfin, une nécessité pour veiller à l’inclusion et à l’employabilité de publics vulnérables, comme les seniors, les femmes, les proches de malades ou les personnes en situation de handicap. »
Lutter contre l’absentéisme
Contribuer à la bonne santé de ses salariés, c’est surtout, pour les dirigeants, s’attaquer à certains postes de dépenses qui peuvent grever la rentabilité. « Contrairement à ce qu’on peut souvent entendre, il y a des actions de prévention qui génèrent du retour sur investissement à court terme, par exemple lorsqu’ils peuvent réduire l’absentéisme », analyse Sophie Agosta, en évoquant un projet développé par Kor pour sensibiliser les salariés sur l’apnée du sommeil. « Les coûts liés à l’absentéisme sont conséquents, ils représentent en moyenne 7% de la masse salariale et 4000 euros par an et par employé, sans oublier l’augmentation soutenue des contrats de couverture complémentaire chaque année, précise Sébastien Abgrall. Le seul fait de mettre en place un programme de suivi de la santé au sein de l’entreprise permet de réduire une part de l’absentéisme. Et 80% des employés estiment que ce type de démarche est un facteur de fidélisation à l’entreprise. »
Favoriser le retour au présentiel
Président et co-fondateur de Medicalib, une start-up de mise en relation entre patients et professionnels de santé de proximité, Nicolas Baudelot rappelle à quel point le modèle français ne favorise pas l’engagement dans la prévention. « Rien ne joue en sa faveur, comme l’illustre l’absence de projection pluri-annuelle dans la gestion des dépenses. » Pour lui, il faut cependant répondre aux attentes grandissantes des salariés. « Aujourd’hui, les entreprises reviennent sur le télétravail et souhaitent restaurer davantage de présentiel, observe-t-il. Pour les salariés, la prise en compte de leur santé et la réalisation d’actions de prévention doivent être plus développés du côté des directions. Cela fait partie des éléments de discussion, avec les partenaires sociaux, en échange du retour sur site. » L’activité de Medicalib en témoigne, selon lui : « en 2025, nous avons pu réaliser plus de 30 000 dépistages au sein de nos entreprises clientes. »
Financer les programmes territoriaux
Comment accompagner et soutenir ces « bonnes intentions » du côté des entreprises, mais aussi des acteurs locaux? Un représentant de la Caisse des Dépôts, Xavier Lacroix, chargé du programme Santé et Grand Age, explique comment l’établissement public place l’action en santé au cœur de sa feuille de route. « Les investissements et les prêts que nous déployons visent à porter des projets contribuant à la cohésion des territoires et à l’harmonisation sociale. Le soutien à la prévention est un élément essentiel de notre politique. » La Caisse des dépôts est l’un des opérateurs, aux côtés de BPIFrance, de l’Appel A Projets (AAP) Prévention, qui mobilise 80 millions d’euros pour financer l’innovation en prévention. « Nous sommes également en soutien des collectivités locales, avec le concours de la Banque des Territoires, pour le déploiement d’initiatives en matière de santé environnementale, par exemple en étendant la place de la nature dans les cœurs de ville. » Le grand atout de ces investissements, c’est qu’ils peuvent être amortis par leurs bénéficiaires sur de très longues périodes. « Ce qui nous intéresse, ce n’est pas le ROI immédiat des prêts que nous attribuons, mais le rendement de projet, précise Xavier Lacroix. L’impact extra-financier, en termes de qualité de vie des populations, constitue la clé de nos process de sélection. »
La prévention, un ROI indéniable
Encourager les entreprises à placer la santé au cœur de leur politique RSE, inciter les collectivités à investir pour le bien-être en santé grâce à des projets urbains bien pensés… ces deux axes illustrent la nécessité de déployer l’effort de prévention au-delà du champ sanitaire. Reste, cependant, à renforcer également le virage préventif du système de santé. Une priorité rappelée à juste titre par Thomas Fatôme, le DG de la CNAM, invité à conclure ces Assises de la Prévention. « Le premier objectif d’un assureur, c’est de tout faire pour que les assurés ne deviennent pas malades, souligne-t-il. Les travaux que nous menons visent notamment à chiffrer ce que rapportent les programmes de prévention. » Il cite plusieurs exemples, comme la mission Retrouve ton Cap (obésité des enfants, 15 millions d’euros économisés par génération), Tabac Info Service (15 à 20 millions d’euros par génération), la campagne de vaccination contre la grippe (45 millions d’euros)… « Si on ajoute ces petits montants, le ROI de la prévention est incontestable. »
Agir avec tous les professionnels
Plus que jamais, l’assurance-maladie a vocation à s’engager dans la prévention, donc, selon son directeur général. Un mouvement qui passe également par le levier des contrats conventionnels signés avec les différentes professions de santé. « C’est le cas, prochainement, avec les infirmiers, qui ont l’avantage d’être 120 000 bien répartis sur le territoire. Cela appelle à redéfinir leurs modalités d’intervention, en harmonie avec les autres professions de santé, et bien sûr les médecins. » Thomas Fatôme évoque de nouveaux champs d’action, comme les bilans de prévention, les actes de vaccination, la participation aux dépistages. « Les négociations sont tarifaires, bien sûr, mais il faut également s’appuyer sur chaque convention pour renforcer la mise en oeuvre opérationnelle de la prévention. »
Industrialiser le ”aller vers”
Appelé à citer les innovations portées par l’assurance-maladie, Thomas Fatôme illustre deux types de démarches opérationnelles. « Nous avons mis en place sept plateformes téléphonique, destinées à ”aller chercher” les personnes éloignées des outils de prévention. 3 millions d’appels ont été passés l’an dernier. » Seconde priorité, la CNAM s’appuie sur Mon Espace Santé pour adresser les messages de prévention de façon ciblée. « C’est, pour nous, un espace d’action à très fort potentiel, permettant d’industrialiser le ”aller vers”, tout en personnalisant les messages afin de toucher des publics larges et divers. »
Hervé Requillart