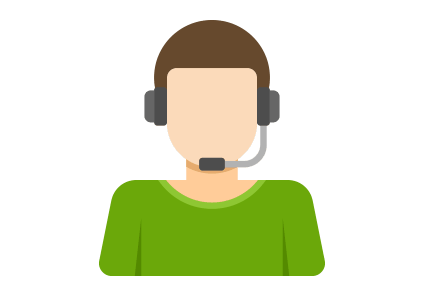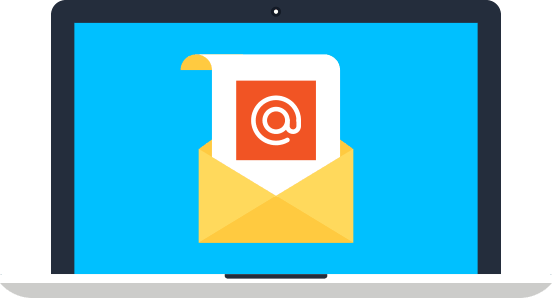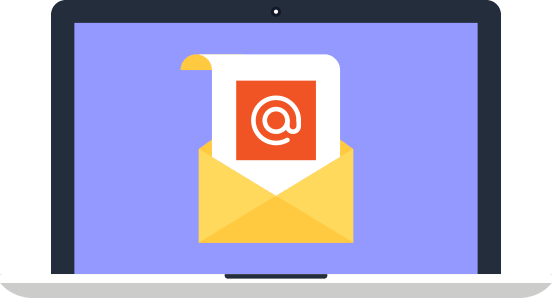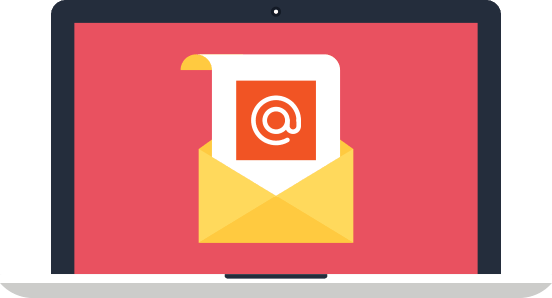Le PFMG 2025 à l’heure du bilan

Arrivant à son terme, le Plan France Médecine Génomique 2025 affiche des résultats contrastés. Son évaluation par les inspections générales est en cours, tandis que s’élabore en parallèle la feuille de route du prochain plan, qui devra – tout comme le premier – « replacer la France dans le peloton de tête de la médecine génomique dans le monde ».
Le 11e congrès de la Société française de médecine prédictive et personnalisée, qui s’est tenu à Paris du 8 au 10 octobre dernier, a consacré l’un de ses dernières sessions à la présentation des résultats du Plan France Médecine Génomique (PFMG) 2025. Lancé en 2016 avec de grandes ambitions (un objectif de 235 000 séquences génomiques produites par an dès 2020 grâce au déploiement d’un réseau de douze plateformes de séquençage couvrant l’ensemble du territoire), le PFMG a connu des débuts chaotiques, l’ampleur et la complexité de la tâche ayant été largement sous-estimées. Mais ces dernières années ont vu une montée en puissance de l’activité sur les deux seules plateformes finalement labellisées – SeqOIA (pour les régions du Centre, du Nord et Nord-Ouest de l’Hexagone) et Auragen (pour l’Est, le Sud-Est, le Sud-Ouest et l’Outre-Mer). 77 préindications cliniques (groupes de pathologies éligibles) ont été validées, 65 pour les maladies rares, trois pour l’oncogénétique (analyse des prédispositions génétiques au cancer) et neuf pour les cancers (génétique somatique).
Une activité en croissance, mais hétérogène en cancérologie
« Toutes préindications confondues, depuis le lancement du plan jusqu’au 31 août dernier, 52 500 prescriptions ont été validées en réunions de concertation pluridisciplinaires et 33 500 comptes-rendus remis au prescripteur », détaille Frédérique Nowak, coordinatrice opérationnelle du PFMG. Le nombre de prescriptions a augmenté de 35 % entre 2023 et 2024. Au total, plus de 100 000 personnes (patients et éventuellement leurs apparentés) ont bénéficié d’un séquençage de leur génome via le plan.
Les maladies rares ont représenté plus de 80 % des prescriptions, contre seulement 19 % pour les cancers et 1 % pour l’oncogénétique. « Un diagnostic causal a pu être obtenu pour presque 24 % des patients atteints d’une maladie rare chez qui un séquençage d’exome n’avait pas permis d’apporter une réponse », relève-t-elle. Si la répartition des prescriptions dans les maladies rares est assez homogène sur le territoire de la métropole, elle reste très hétérogène dans les cancers (avec une prédominance de l’Ile-de-France, de l’Ouest et du Sud-Est) ; une amélioration est toutefois constatée au premier semestre 2025.
Lancé avec des années de retard, le Collecteur analyseur de données (CAD), infrastructure nationale devant permettre l’accès aux données du PFMG à des fins de recherche, « est en train de devenir opérationnel. Deux premiers projets dans des maladies rares ont eu accès à leur « bulle sécurisée » pour commencer leurs premiers traitements de données, et les bulles sont en train de se mettre en place pour deux prochains projets », annonce Frédérique Nowak. Une évaluation des implications médico-économiques du plan est également en cours, dans le cadre du projet Seqogen.
Augmenter la qualité des échantillons
Parmi les difficultés rencontrées, les participants ont mis en avant un enjeu très technique mais loin d’être anecdotique dans le champ du cancer : la difficulté de conduire des analyses pangénomiques sur des échantillons tumoraux FFPE (fixés au formol et inclus en paraffine), « gold standard » de l’analyse histologique. Durant leurs premières années d’activité, seuls des prélèvements congelés étaient traités par les plateformes. C’est seulement à partir de 2023 que de premiers prélèvements FFPE ont pu leur être adressés (depuis juillet en provenance d’Outre-Mer pour toutes les préindications de cancérologie, depuis novembre de métropole pour quatre préindications seulement), dans le cadre d’une phase pilote. Cette expérimentation a confirmé la faisabilité d’analyses ADN/ARN à haut débit sur des prélèvements FFPE, mais celles-ci demandent plus de temps et de ressources, avec à l’arrivée davantage de comptes-rendus non concluants qu’avec des échantillons congelés. En l’état actuel, « ceux-ci sont à privilégier, mais on a bien conscience qu’on ne peut pas avoir ce type de prélèvement chez certains patients, reconnaît Anne Mc Leer, de la plateforme Auragen. Notre message est qu’il faut absolument augmenter la qualité des prélèvements FFPE, pour que les analyses aient une meilleure chance de succès ». De son côté, le CRefIX (Centre de référence technologique, d’innovation et de transfert), infrastructure rattachée au PFMG, expérimente des méthodes de conservation alternatives pour « réconcilier le FFPE avec le séquençage », espère son directeur Jean-François Deleuze.
Un prochain plan commandé
Au-delà de ces aspects techniques, d’importantes marges de progrès demeurent concernant notamment l’interprétation et le partage des données et la complexité du parcours. Pour autant, « le plan a réussi à sécuriser le séquençage du génome dans le système de soins en France dans les maladies rares et les cancers », se réjouit Frédérique Nowak. Ses résultats ont convaincu les pouvoirs publics qui, sans attendre les conclusions de l’évaluation du PFMG 2025 actuellement conduite par les Inspections générales des Affaires sociales (IGAS) et de l’Education, du Sport et de la Recherche (IGESR), ont commandé un nouveau plan. « C’est une très bonne nouvelle de se dire qu’après 2025, tout ne s’arrêtera pas et que l’on va pouvoir poursuivre le développement de la médecine génomique en France », applaudit le Pr David Geneviève, chef du département de génétique médicale du CHU de Montpellier. Il est l’une des trois « personnalités qualifiées » (avec le Pr Frédérique Penault-Llorca, du Centre Jean-Perrin à Clermont-Ferrand, et Alexandre Reymond, de l’Université de Lausanne) chargées de la co-rédaction, avec cinq inspecteurs de l’IGAS et de l’IGESR, d’un rapport qui sera remis au gouvernement en mars 2026.
Anticiper une montée en volume
« Le futur plan devra absolument être articulé avec le quatrième Plan national maladies rares (lancé en février dernier), dont l’axe diagnostic est indissociable du PFMG : il faudra des échanges réguliers », plaide le Pr Sylvie Odent (CHU de Rennes), co-coordinatrice du suivi du PNMR4. Pour David Geneviève, l’un des sujets majeurs à mettre sur la table sera l’ouverture, dans un cadre de recherche, des parcours de médecine génomique en population générale, dans une optique de prévention. « Auquel cas le volume de séquences à produire et analyser ne sera plus du tout le même ! Si on veut augmenter l’accès au diagnostic et au dépistage, il faudra accroître soit le nombre de plateformes soit les capacités des plateformes actuelles : cela fait partie des éléments à discuter lors de l’écriture du prochain plan. » « Du fait de l’extension du séquençage en routine du génome aussi bien pour le diagnostic que le dépistage des maladies rares, rester avec deux plateformes ne sera pas tenable », confirme Sylvie Odent. Quelques jours plus tôt, en marge du congrès RARE à Paris, le Pr Véronique Paquis, chef de service de génétique médicale au CHU de Nice, estimait nécessaire d’ouvrir aux acteurs privés l’activité de séquençage, « en conditionnant le remboursement des actes, s’il y en a un, au transfert vers le CAD des séquences produites dans ce cadre, pour alimenter les travaux de recherche. » « Si le patient le souhaite, le partage des données pour la recherche, de manière sécurisée, est indispensable ! », affirme David Geneviève. Tout en soulignant que la question d’un futur remboursement dans la nomenclature des actes de séquençage du génome n’est toujours pas tranchée.
Julie Wierzbicki