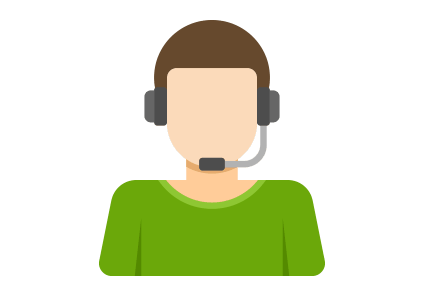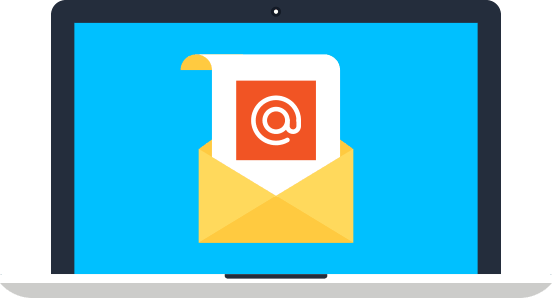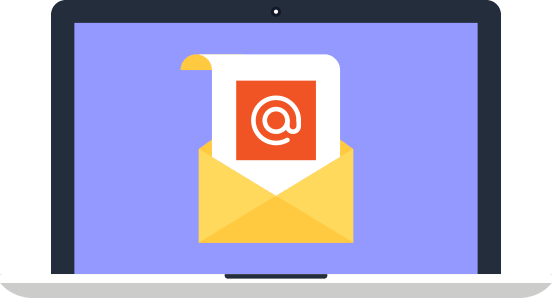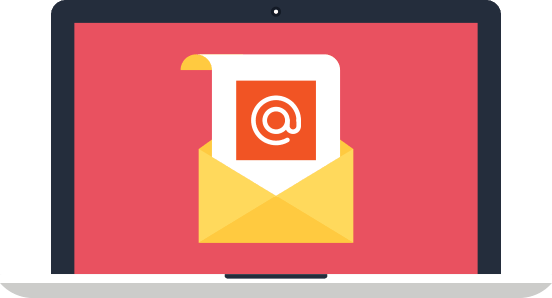Maladie d’Alzheimer : les défis territoriaux de la structuration des soins

Le colloque de Pharmaceutiques s’est attaché à l’organisation des soins au service des patients atteints d’Alzheimer, ou maladies apparentées, alors que la nouvelle stratégie nationale maladies neurodégénératives vient d’être publiée début septembre.
« La structuration des soins des patients atteints d’Alzheimer, ou maladies apparentées, semble bien organisée sur le papier, avec les 450 centres de consultations mémoire sur le territoire français, et les 31 Centres Mémoire de Ressources et de Recherche (CMRR), a indiqué le Pr Claire Paquet, neurologue, chef du Centre de neurologie cognitive et unité maladie à corps de Lewy à l’Hôpital Lariboisière Fernand-Widal (Paris), lors de la deuxième table-ronde du colloque de Pharmaceutiques dédié à la maladie d’Alzheimer (1). Cependant, un décalage persiste entre l’offre théorique et la réalité des ressources humaines, avec des inégalités territoriales d’expertise difficiles à réduire. » La collaboration avec les médecins traitants reste complexe, bien que des outils comme l’application MemScreen facilitent un repérage plus rapide des patients nécessitant une évaluation approfondie, comme discuté par les intervenants de la première table-ronde. David Wallon, neurologue au CMRR de Rouen, président de la Fédération des Centres Mémoires, confirme que les recommandations de diagnostics ont été coécrites avec le CMG (Collège de médecine générale).
Le professeur Wallon insiste sur le rôle des CMRR, qui disposent de pôles d’excellence, pour assurer des consultations, un soutien par ses ressources et de la recherche, partout grâce à leur maillage territorial, et leur approche partenariale. « La collaboration existante avec les infirmières spécialisées (Asalée – dans le dispositif Action de Santé Libérale En Équipe) et avec des Infirmières en Pratique Avancée (IPA) qui seraient spécialisées en maladies neurodégénératives, pourrait être une réponse adaptée aux attentes des patients pour améliorer le suivi », assure-t-il. La maladie d’Alzheimer est désormais vue comme une maladie chronique longue, nécessitant une prise en charge globale avec de nombreux acteurs, et la lutte contre la stigmatisation. Benoit Durand, directeur délégué de l’association France Alzheimer, est dans l’attente d’un comité de pilotage de la Stratégie nationale maladies neurodégénératives et de financements concrets, afin d’effectivement réduire ce délai diagnostic et d’accompagner la vie du patient après le diagnostic.
Accompagner les patients et leurs aidants
« Les droits des personnes malades et de leurs aidants sont méconnus, poursuit Benoit Durand, notamment dans le cadre de leur activité professionnelle. Les structures de répit pour les proches aidants (initiées par le Plan Alzheimer 2008-2012), sont aujourd’hui ouvertes à toute personne en perte d’autonomie, avec des professionnels pas forcément formés aux maladies neurodégénératives, alerte-t-il. Par ailleurs, leur accès reste inégal ». Les entreprises ont un rôle à jouer. Barbara De Vos, responsable des affaires publiques, de la communication et des relations avec les associations de patients d’Eisai, rappelle que le groupe japonais met en avant une philosophie centrée sur la compréhension des patients et familles (human health care – HHC), invitant ses employés à consacrer 1 % de leur temps de travail (soit deux jours par an) à cet engagement. Au Japon, une loi fondamentale sur la démence et l’inclusion dans la société a été adoptée en 2023, visant à promouvoir des mesures globales pour que les personnes atteintes vivent avec dignité et espoir, en facilitant le maintien à l’emploi, l’insertion sociale et l’autonomie, et en changeant le regard sur la maladie. « La loi est le bon niveau », estime-t-elle.

Des conséquences pour le bien-vieillir
Le député de l’Aveyron Jean-François Rousset insiste sur l’impact sociétal des maladies neurodégénératives et la nécessité d’organiser un parcours de soins pour maintenir la qualité de vie. « Le sujet est très difficile pour les aidants qui s’épuisent », constate-t-il. Le groupe d’étude Alzheimer et maladies neurodégénératives à l’Assemblée nationale qu’il co-préside regroupe 80 membres et travaille avec les ministères pour faire avancer les plans d’action, incluant la prévention et la déstigmatisation. Il attend beaucoup de sa prochaine rencontre avec Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées, car « le plan « Grand âge » dont les maladies neurodégénératives font partie, attendu depuis des années, a du mal à se mettre en route. La consultation d’annonce, moment clé pour préparer les mois d’évolution à venir, nécessite beaucoup de pédagogie. » Monique Girard, directrice médicale et référente gériatrique de Colisée France, souligne que 70 % des résidents entrant en Ehpad ont une maladie neurodégénérative, souvent à un stade avancé, thème de la troisième table-ronde du colloque sur les conséquences pour le bien-vieillir. « L’accueil des patients et de leurs proches implique un fort besoin de formation des soignants, indique-t-elle. La promotion d’approches non médicamenteuses comme la méthode Montessori adaptée aux patients, visant à redonner autonomie et repères, est très valorisante pour le malade lui-même et ses proches. La HAS a publié de nouvelles recommandations sur ces accompagnements non médicamenteux, insistant sur la pertinence des interventions selon les symptômes. » Monique Girard fait ainsi la promotion « du juste soin et des prescriptions pertinentes ». Christine Tabuenca, directrice de la Fondation Médéric Alzheimer, met en avant l’importance des sciences humaines et sociales dans la prise en charge, avec un observatoire sur la maladie et des enquêtes dans les structures d’accueil des personnes âgées. Le guide des interventions non médicamenteuses publié en 2021 de la Fondation promeut des activités comme l’art-thérapie, la musicothérapie, le Snoezelen, … parmi d’autres activités de soins et d’ateliers occupationnels. « Nous menons une étude clinique sur le rôle de la gym douce pour réduire l’angoisse et renforcer le lien entre le couple aidant/aidé et avec les professionnels ». Elle souhaiterait que ces interventions soient davantage valorisées dans la stratégie nationale neurodégénérative 2025-2030.

Défis et innovations dans les ressources humaines
Jean-Benoît Dujol, directeur général de la cohésion sociale, rappelle que le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre de personnes en perte d’autonomie posent un défi majeur en termes de ressources humaines qualifiées. La Dress (2) et l’Insee (3) chiffrent la croissance du nombre de personnes en perte autonomie à + 700 000 personnes d’ici 2050, dont 300 000 de celles en perte d’autonomie grave. Le programme national Prendresoin.fr, lancé en novembre 2024 par le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités, et des Familles, et France Travail, vise à renforcer l’attractivité et l’emploi dans les métiers du soin et de l’accompagnement social, avec l’objectif de former, recruter et fidéliser près de 500 000 professionnels d’ici 2030. Une campagne multicanale lancée depuis le 5 octobre 2025 cible particulièrement les jeunes et les actifs en reconversion. « La question de la rémunération, de la formation et de la qualité des compétences est centrale », estime la DGCS. Son directeur souligne la pénibilité du travail, notamment chez les Accompagnants Éducatifs et Sociaux (AES), avec un taux élevé d’accidents du travail et de burn-out. « Nous devons ainsi renforcer notre expertise interne sur les données en s’appuyant sur la masse de data, issues de la Dress, de l’Insee et de la Dares (4), à exploiter pour mieux comprendre », conclut-il.
Juliette Badina
(1) Evènement organisé le 18 novembre avec le soutien institutionnel de la Fondation Recherche Alzheimer et du laboratoire Eisai
(2) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques – Dress
(3) Institut national de la statistique et des études économiques – Insee
(4) Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques – Dares