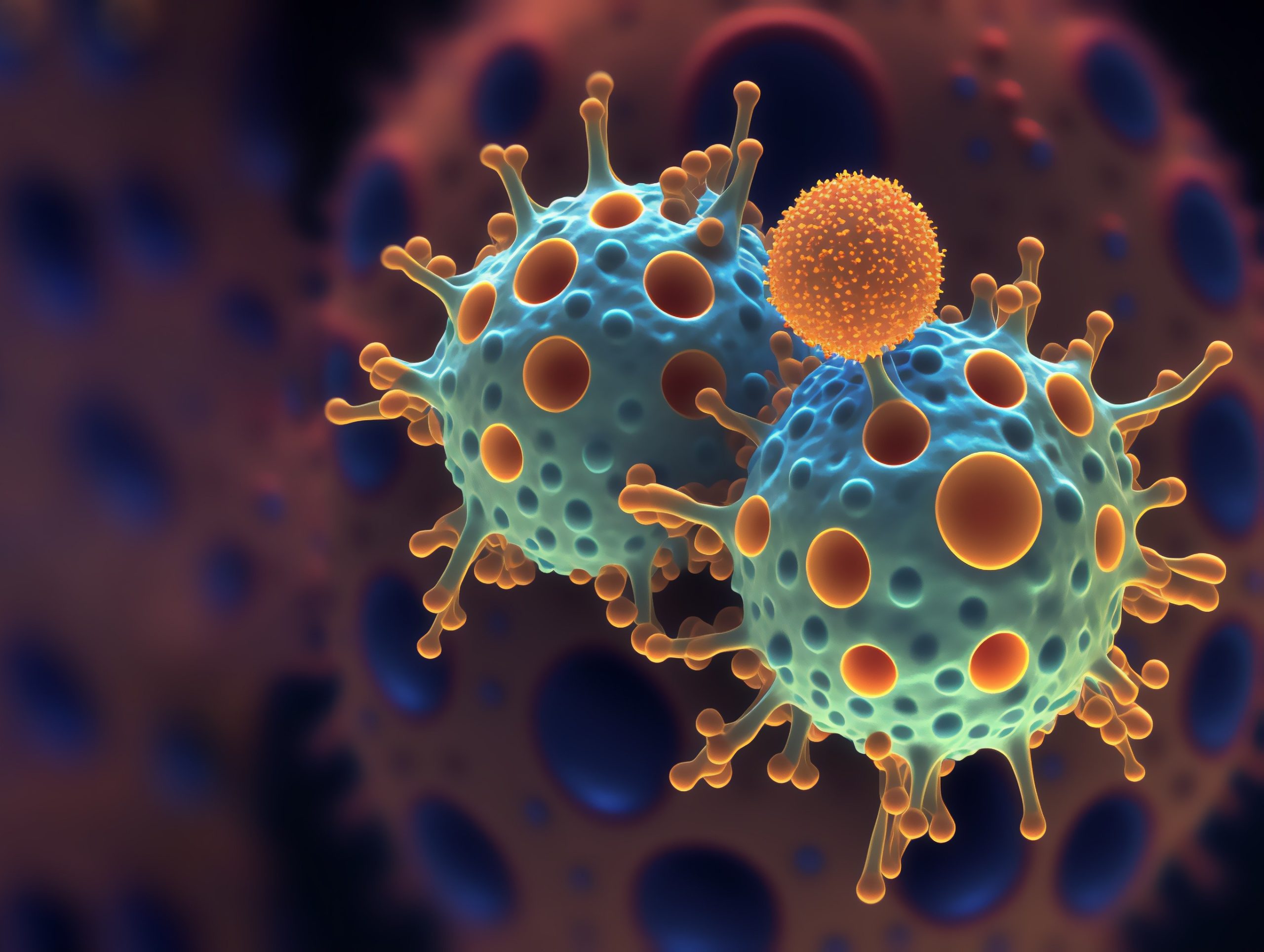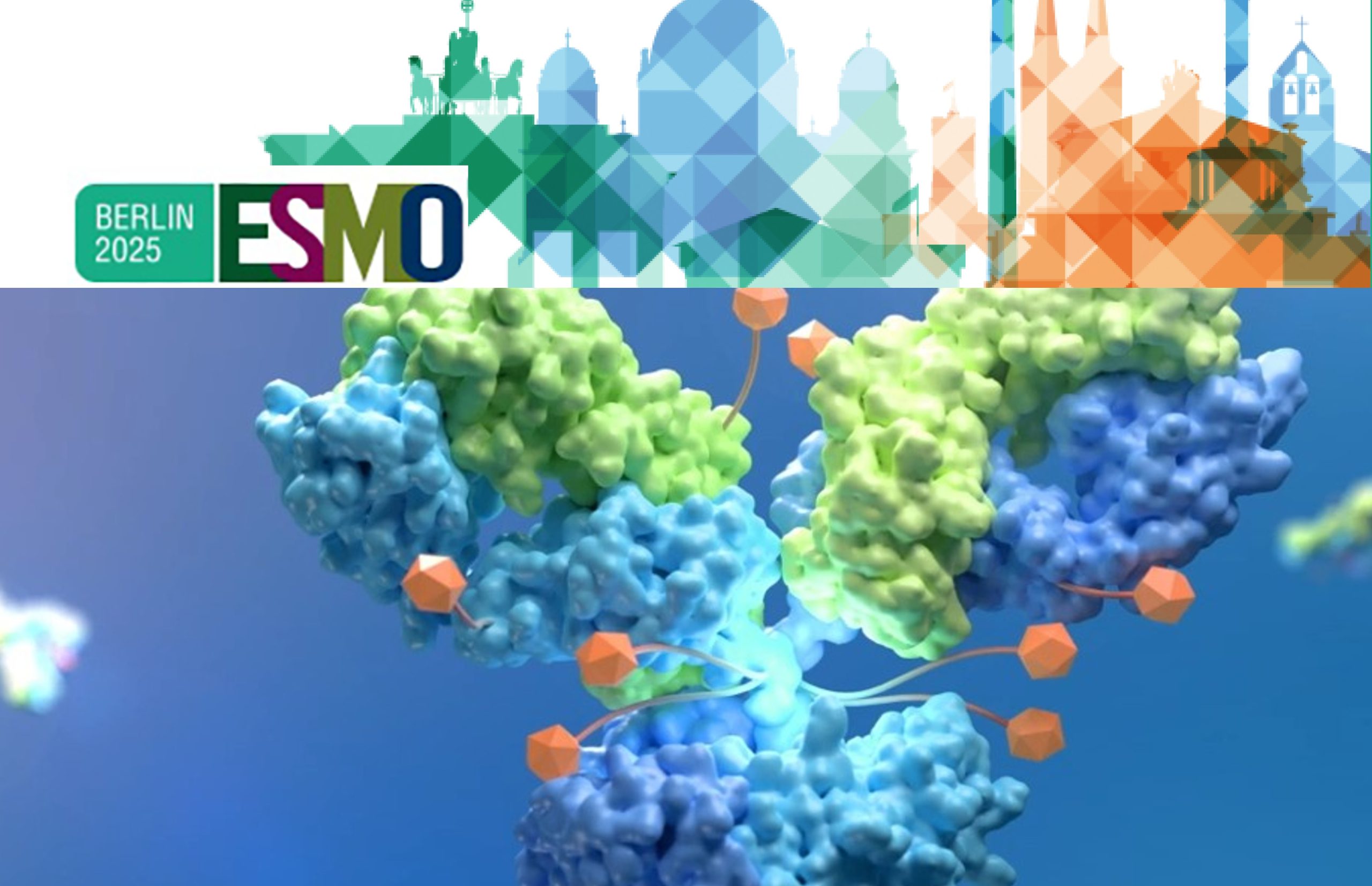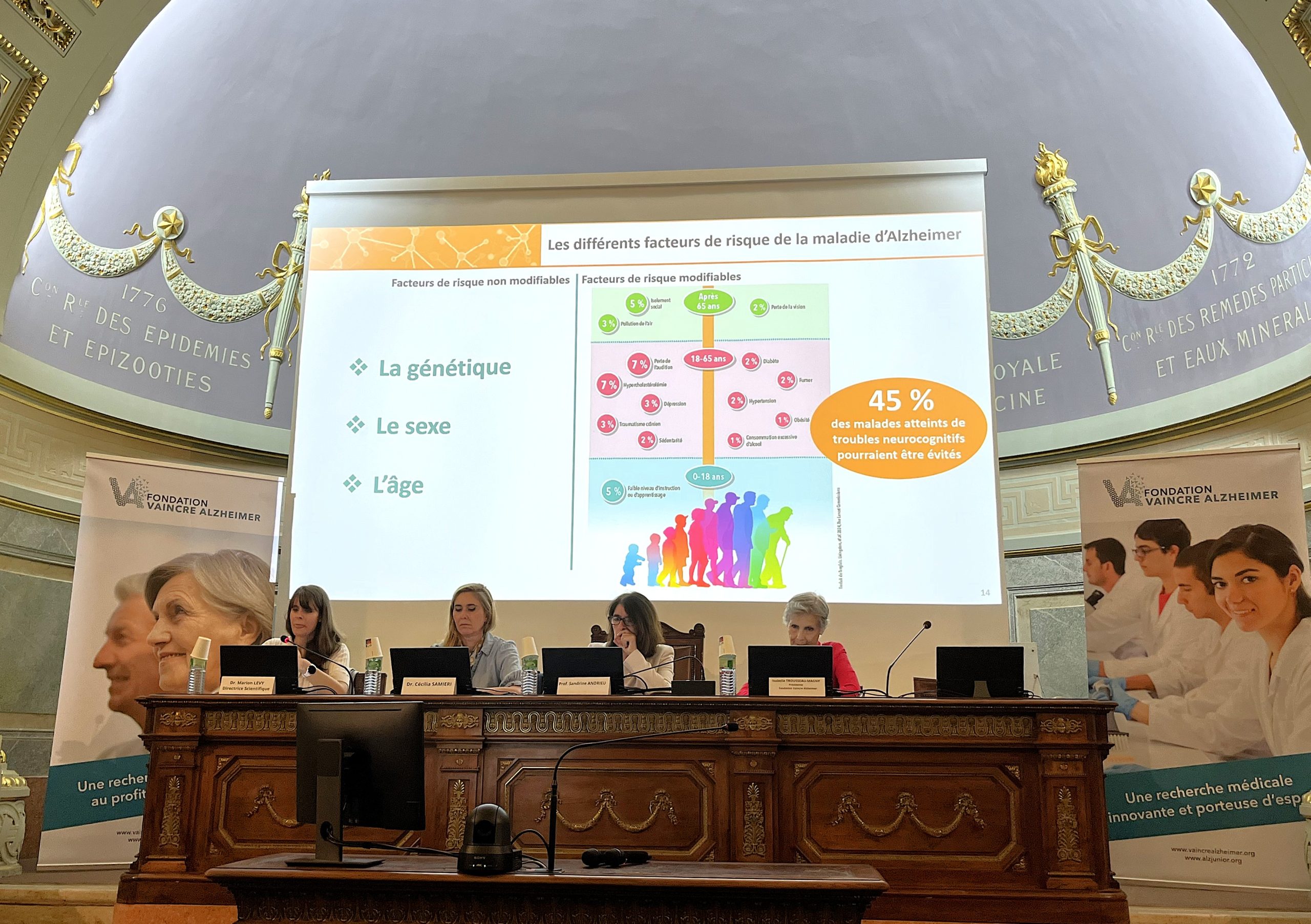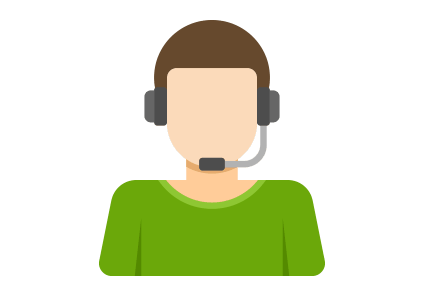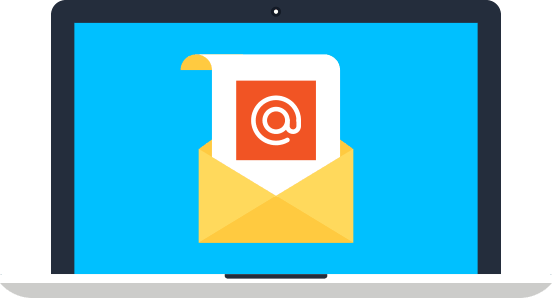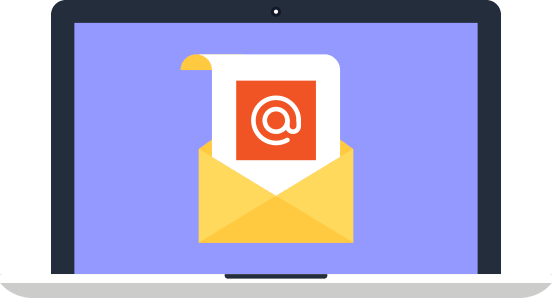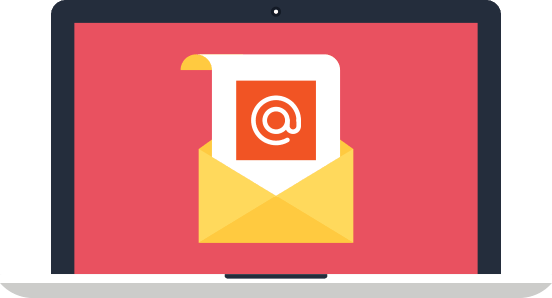AFM-Téléthon : entre avancées et frustrations

Les résultats des recherches soutenues par l’AFM-Téléthon dans les maladies génétiques bénéficient désormais aux patients dans un nombre croissant de pathologies. Mais alors que les projets d’essais cliniques se multiplient, l’association doit faire des choix, faute de relais financiers.
Ce sont deux petites filles à couettes qui ont accueilli les participants à la conférence de presse scientifique de l’AFM-Téléthon, organisée le 25 novembre par l’association en amont de son marathon caritatif télévisuel annuel. Marley et Mylane, des jumelles aujourd’hui âgées de deux ans, ont été dépistées à la naissance d’une amyotrophie spinale dans le cadre du programme expérimental DEPISMA, et ont pu ainsi bénéficier d’une thérapie génique avant l’apparition des premiers symptômes. Leurs courses à travers l’auditorium de l’Institut de Myologie à Paris témoignent de la réussite du traitement, alors que dans la forme la plus sévère de cette maladie rare – dont elles étaient atteintes – l’espérance de vie médiane est d’environ deux ans. Le dépistage néonatal de cette maladie est désormais généralisé en France, depuis le 1er septembre dernier.
« De la connaissance du gène au médicament », l’histoire du développement d’une thérapie génique contre l’amyotrophie spinale « est le chemin idéal pour un grand nombre de maladies génétiques ! », applaudit Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’association. Elle rappelle notamment le rôle joué par les équipes de Judith Melki (Hôpital Necker) dans l’identification du gène responsable en 1995, et de Martine Barkats (Généthon) dans la mise au point de la stratégie thérapeutique à la fin des années 2010.
Essai pivot en cours dans la myopathie de Duchenne
L’AFM-Téléthon trace aujourd’hui le même chemin pour d’autres pathologies, à commencer par la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD), « maladie emblématique » autour de laquelle avait été organisée en France la première émission télévisée du Téléthon en 1987. Cette maladie liée à l’X est la plus fréquente des myopathies (une naissance de garçon pour 5 000). « Nous travaillons depuis plus de vingt ans au développement d’une thérapie génique », rappelle Frédéric Revah, directeur général de Généthon. Le gène muté étant « le plus long du génome humain », et pour cette raison impossible à vectoriser en l’état, les chercheurs ont notamment dû créer un « gène médicament » plus court, capable de coder pour une protéine fonctionnelle, la microdystrophine.
Cette nouvelle thérapie a déjà été injectée à cinq enfants lors d’un essai de phase I/II initié en 2021. Deux ans après l’injection – et même trois ans pour l’un deux – les trois patients ayant reçu la dose la plus élevée montrent une stabilisation à la fois des biomarqueurs biologiques et de la fonction locomotrice, contre une diminution significative chez les patients non traités. Un essai randomisé de phase III à visée d’enregistrement a d’ores et déjà démarré à la fin de l’été dernier en Europe (14 sites en France, Belgique, Espagne et Royaume-Uni), avec un objectif de recrutement de 70 enfants : les résultats sont attendus pour fin 2027.
Un nombre croissant d’études cliniques
13 candidats médicaments issus de la recherche de Généthon sont actuellement évalués dans des essais cliniques, dans d’autres maladies génétiques neuro-musculaires comme la myopathie des ceintures liée au gène FKRP, avec de premiers résultats probants, ou encore dans une maladie hépatique rare, le syndrome de Crigler-Najjar. Dans cette dernière pathologie, pour certains des neuf patients déjà traités, l’effet de la thérapie semble diminuer avec le temps : une réflexion est en cours pour adapter le protocole. Sept autres essais sont prévus dans les trois ans à venir, dont un dans la calpaïnopathie, la myopathie des ceintures la plus fréquente, pour laquelle un vecteur a été conçu sur mesure par les équipes du laboratoire.
Et l’AFM-Téléthon soutient également d’autres travaux conduits en dehors de Généthon, en amont des essais cliniques, allant de pathologies ultra-rares comme la maladie de Danon (caractérisée par une cardiomyopathie sévère) à plus fréquentes telle la drépanocytose (affectant la capacité des globules rouges du sang à transporter l’oxygène).
Le financement manque pour tout porter
Si l’AFM-Téléthon tient à mettre en avant les « bonnes nouvelles » que représentent ces avancées thérapeutiques, l’inquiétude perce à l’heure d’évoquer le financement des projets. Le constat est sans appel : « Nous n’avons pas les moyens de porter tous les programmes qui nous sont proposés. Il nous faut faire des choix, et c’est une frustration extrême », déplore Laurence Tiennot-Herment. Rien que le programme de phase III et la préparation du dossier d’enregistrement du candidat dans la DMD nécessitent un budget évalué à plus de 100 millions d’euros pour les trois années à venir… à mettre en regard des 96,6 M€ levés au total à l’issue de la collecte du Téléthon 2024. Un financement de 19,6 M€ de Bpifrance dans le cadre de France 2030 « doit encore être confirmé », indique la dirigeante. « Nous avons démarré l’exploration de possibles partenariats industriels, mais nous ne voyons rien de satisfaisant à ce jour », ajoute Frédéric Revah. Plus que jamais, l’association comptera sur la générosité du public lors de la prochaine édition du Téléthon, les 5 et 6 décembre, dont le slogan sera cette année : « Ensemble faisons bouger les lignes ».
Julie Wierzbicki