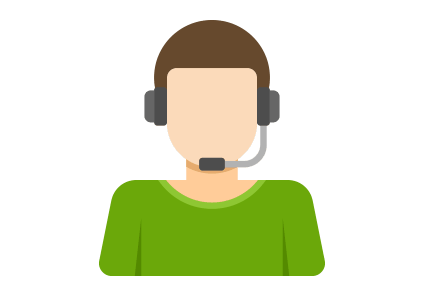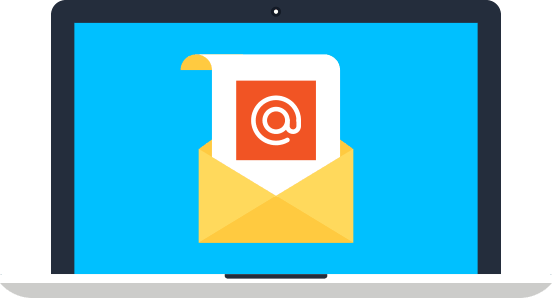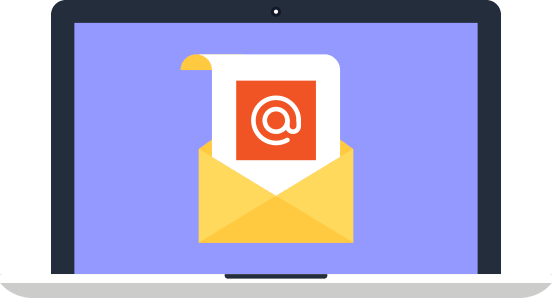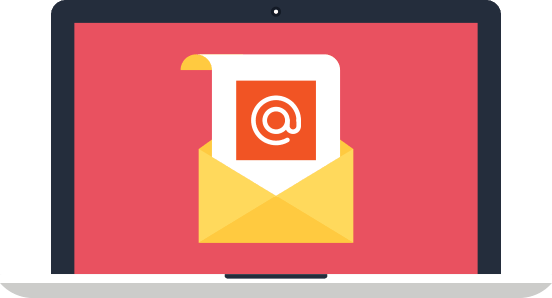Alzheimer : mieux comprendre pour mieux diagnostiquer

Alors que l’on comprend de mieux en mieux la physiopathologie de la maladie d’Alzheimer et que l’on espère l’arrivée prochaine en France de nouveaux traitements, la bonne structuration du parcours diagnostic et le développement de nouveaux outils seront clés pour détecter au plus tôt la maladie et mieux la prendre en charge.
Même si les échecs thérapeutiques ont été nombreux, les années d’efforts dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer ont apporté d’immenses progrès dans sa compréhension, comme l’ont rappelé les participant à la web-émission organisée par Pharmaceutiques le 18 novembre dernier (1). La reconnaissance de l’implication de deux protéines (amyloïde et Tau) et deux processus (l’inflammation et la neurodégénérescence) ont permis de développer des biomarqueurs pour identifier in vivo ces différentes lésions neuropathologiques. Mais aussi, de mieux appréhender la dynamique de la maladie, avec une longue phase silencieuse de près de vingt ans précédant l’apparition des symptômes, souligne le Pr Julien Delrieu, responsable du centre mémoire du Gérontopôle de Toulouse. « Il nous faut encore comprendre l’articulation entre le vieillissement biologique et les maladies liées à l’âge », note-t-il Le repérage précoce du déclin des capacités intrinsèques fait partie des axes forts développés au Gérontopôle, via le déploiement du programme ICOPE (Integrated Care for Older People – initiative lancée par l’OMS) avec l’objectif de repérer le plus tôt possible les premiers signes de fragilité, grâce à un questionnaire proposé sur une application mobile.
Le médecin généraliste en première ligne
Selon Julien Delrieu, « le diagnostic d’Alzheimer se fait trop tardivement en France comme partout, très probablement parce qu’à ce jour nous manquons un peu d’interventions à proposer à nos patients. » Or « pouvoir diagnostiquer la maladie à un stade précoce est un enjeu majeur, confirme le Pr Julien Dumurgier, neurologue à l’Hôpital Lariboisière (AP-HP). Dès les premières plaintes cognitives il est important de faire un bilan ». « Ce diagnostic que l’on dit « précoce » est en fait très tardif ! commente Rémy Genthon, directeur scientifique de la Fondation Recherche Alzheimer. Quand on détecte la maladie alors que les symptômes sont déjà là, on intervient très tard dans l’histoire. » Face à cette plainte cognitive, c’est au médecin généraliste d’établir le premier bilan, « et il faudra lui fournir les outils de repérage, notamment numériques, pour cela. » MemScreen, application mobile développée par les équipes de l’Hôpital Lariboisière, permet au médecin de tester en quatre minutes la mémoire récente et l’efficience cognitive globale de son patient. « Et il faut que le généraliste ait le réflexe de prescrire les examens adéquats avant de passer la main à un spécialiste, afin de gagner du temps », insiste Rémy Genthon.
Des biomarqueurs éprouvés ou encore exploratoires
Si ces tests confirment les troubles cognitifs, le patient est adressé vers une consultation mémoire, où est réalisé le diagnostic clinico-biologique de la pathologie. Celui intègre plusieurs types d’examens : l’évaluation neuro-psychologique (mesure des fonctions cognitives), et la détection des biomarqueurs. L’examen de référence est le dosage des protéines dans le liquide céphalo-rachidien, et on peut aussi recourir au PET-Scan. Mais ce dernier, moins invasif, est aussi plus coûteux et moins informatif car la protéine Tau est moins accessible par l’imagerie nucléaire. « L’évolution de ces outils diagnostics permet aujourd’hui de déterminer très précisément l’existence ou non de la maladie d’Alzheimer chez quelqu’un qui présente des premiers troubles », se réjouit le Pr Dumurgier. Les biomarqueurs sanguins – accessibles par une simple prise de sang – pourront-ils changer la donne ? « La validité d’un test biologique est liée au public auquel il s’adresse, rappelle Rémy Genthon. Si on cible un large public dont la grande majorité n’a pas la pathologie, on va augmenter considérablement le nombre de faux positifs, et la valeur prédictive du test s’approche de zéro. Sans parler du risque d’engorgement dans les laboratoires d’analyse spécialisés. La position actuelle, qui me paraît raisonnable, est de dire que le premier échelon doit rester le médecin généraliste pour l’orientation vers des spécialistes qui eux se chargeront du diagnostic de précision. »
En matière d’outils diagnostics, « la Fondation Vaincre Alzheimer finance de nombreux projets très novateurs », signale sa directrice scientifique, le Dr Marion Levy, soulignant notamment le potentiel des travaux sur l’œil. « Parmi les projets que l’on soutient, une équipe toulousaine examine un lien potentiel entre une dilatation anormale de la pupille et l’accumulation précoce de la protéine Tau dans une région spécifique du cerveau : c’est un domaine vraiment exploratoire. Une équipe de Tours essaye aussi de détecter des biomarqueurs dans les larmes. En complément des tests actuels cela permettrait d’apporter d’autres informations. »
Vers une médecine de précision ?
L’amélioration du diagnostic a permis de conduire des essais cliniques en intervenant plus précocement, sur des patients réellement porteurs de la maladie d’Alzheimer. « Il a ainsi été possible d’objectiver un effet positif, mais limité et partiel, des thérapies dirigées contre la protéine amyloïde, rappelle le Pr Delrieu. L’on comprend désormais que celle-ci ne joue pas un rôle exclusif dans cette maladie multifactorielle. L’avenir passera probablement par une combinaison de ces médicaments avec d’autres interventions, médicamenteuses ou non, visant d’autres mécanismes. » « Ces essais nous ont appris que l’on ne pourra pas traiter tous les patients avec un seul médicament, du fait de la spécificité de chaque individu, renchérit Jérôme Braudeau. Comme en cancérologie, il va falloir mettre en place une médecine de précision… ce que ne permettent pas les biomarqueurs actuels, qui ne considèrent qu’un seul élément dans le spectre multifactoriel de la maladie ». L’avènement de cette médecine de précision dans cette nouvelle aire thérapeutique passera selon lui par le développement de tests et de biomarqueurs permettant de prédire quels patients développeront des symptômes de maladie d’Alzheimer avancée, de stratifier finement ces personnes, et de déterminer la vitesse de progression de la maladie, afin de pouvoir la traiter au plus tôt. La société AgenT, qu’il a cofondée et qu’il dirige, conduit actuellement une étude clinique pour évaluer un panel de biomarqueurs chez plus de 4 000 participants présentant ou non un trouble cognitif léger, avant la pose d’un diagnostic. « Notre objectif est d’atteindre une valeur prédictive de 85 à 90 %. » Il imagine dans l’avenir une convergence des différents outils aujourd’hui en développement dans un test commun, associant des marqueurs digitaux (volet cognitif) et biologiques sanguins, « avec l’interprétation la plus simple possible. »
Tous acteurs de la prévention
En amont, les intervenants ont rappelé l’importance de la prévention primaire et secondaire de la maladie. « Aujourd’hui l’activité physique est le meilleur « géronprotecteur » disponible ! Mais les pouvoirs publics consacrent trop peu de moyens à la prévention, regrette Julien Delrieu. Et ce n’est pas après 70 ans qu’il faut développer ces stratégies : c’est dès 50 ans, quand les capacités intrinsèques commencent à décliner, que l’on doit intervenir. » « La prévention primaire est bien sûr essentielle, renchérit Marion Levy. Notre rapport de recherche était cette année centré sur la prévention, afin notamment d’informer le public sur les moyens d’action à l’échelle individuelle, liés à nos modes de vie ». Mais il existe aussi des facteurs non modifiables, comme la génétique, et d’autres pour lesquels les leviers d’action nécessitent l’intervention des pouvoirs publics, comme la pollution atmosphérique : « c’est un sujet sur lequel tout le monde doit s’engager au niveau national, voire international. »
Julie Wierzbicki
(1) Evènement organisé avec le soutien institutionnel de la Fondation Recherche Alzheimer et du laboratoire Eisai