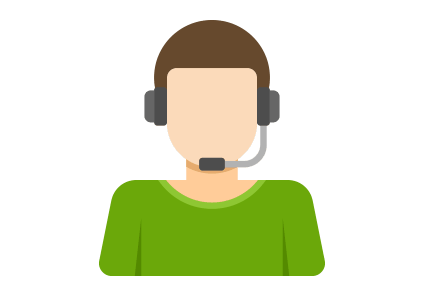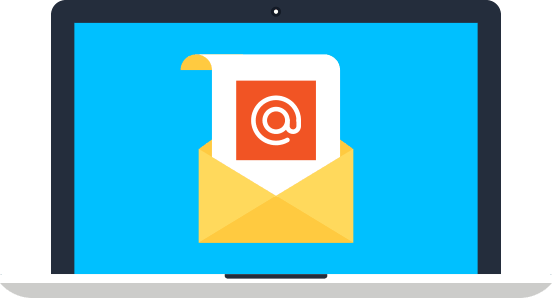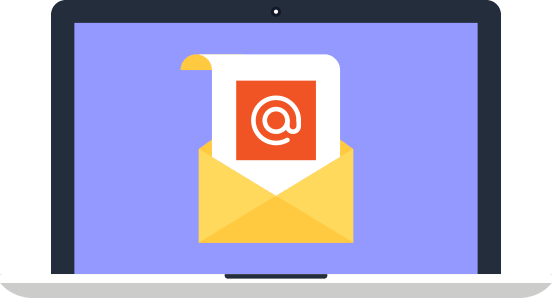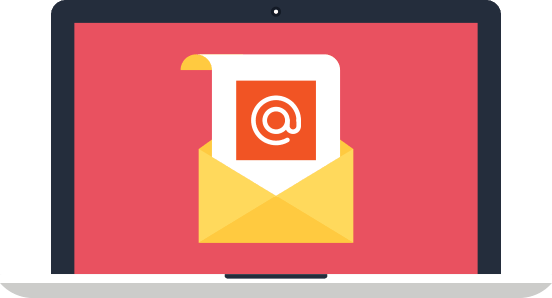Bioproduction : rattraper le retard, bâtir l’avenir

Stratégie d’accélération dédiée et investissements de France 2030, structuration de l’écosystème… Les autorités et les acteurs de la filière mettent les bouchées doubles pour faire de la France un pays leader en bioproduction d’ici la fin de la décennie, comme l’illustrent les experts participant au colloque « Souverainetés en santé » de Pharmaceutiques. Et ce alors que la part des médicaments biologiques dans l’arsenal thérapeutique pourrait selon les estimations atteindre 50 % d’ici cinq ans.
Produits issus du fractionnement du plasma, protéines recombinantes, ARN ou médicaments de thérapie innovante (MTI : thérapie génique ou cellulaire)… Alors que 59 % des candidats médicaments aujourd’hui en développement sont des biothérapies, la France n’est que le 4e producteur européen derrière l’Allemagne, l’Italie et la Suisse. Pour autant, Anne Jouvenceau, de l’Agence de l’Innovation en Santé (AIS), refuse de parler de « retard français ». « Nous ne sommes pas dans une logique de réindustrialisation, mais plutôt de construction : il ne s’agit pas de réparer mais de poser les bases », a-t-elle rappelé en introduction de la deuxième table ronde du colloque Souverainetés en santé organisé par Pharmaceutiques le 28 mars dernier (1). Cette « construction » repose sur la stratégie d’accélération Biothérapie bioproduction en thérapies innovantes, qu’elle coordonne. Lancée en janvier 2022 avec un financement de 800 M€ de France 2030, pilotée par l’AIS en s’appuyant sur deux opérateurs, la banque publique d’investissements (Bpifrance) et l’Agence nationale de la recherche (ANR), cette stratégie « s’inscrit sur un temps long : nous n’en verrons véritablement les fruits que dans 10 à 15 ans », prévient Anne Jouvenceau. L’objectif est bien sûr d’accroître les capacités de production via de nouvelles lignes, l’industrialisation des procédés ou encore la création d’« usines miniatures » au plus proche des patients pour la production de MTI. Mais des progrès scientifiques ont déjà été réalisés pour améliorer par exemple l’efficacité des biothérapies anticorps, la délivrance mucosale des vaccins à ARN messager ou encore la modélisation grâce aux organes sur puce. « 66 % du budget de la stratégie a déjà été engagé, avec plus de 120 projets financés et plus de 400 partenaires mobilisés », se réjouit-elle.
Travailler ensemble à lever les freins
Toutes les biothérapies ne font pas face aux mêmes défis techniques. Engagée dans la production d’ARN messager en continu, la société Dillico, basée à Meylan (Isère), mise sur les avantages de cette nouvelle modalité par rapport aux protéines recombinantes. « La production peut être réalisée en petits volumes, hors de la cellule. C’est le corps du patient qui produit la protéine-médicament : une approche vraiment révolutionnaire ! », s’enthousiasme Emmanuel Gaud, directeur des opérations et co-fondateur de Dillico. Pour accompagner la prise de risque inhérente au développement de nouvelles molécules, la société propose des équipements de production multi-échelle. De son côté, la start-up franco-américaine WhiteLab Genomics s’appuie sur l’intelligence artificielle pour mettre au point les meilleurs vecteurs (spécificité, faible immunogénicité, coût réduit) pour la délivrance des traitements à base d’ADN ou d’ARN.
Pour créer des synergies entre l’ensemble des acteurs de l’écosystème, l’association France Biolead a vu le jour fin 2022, soutenue par l’engagement des pouvoir publics et d’acteurs « qui veulent jouer collectivement », constate son directeur général Laurent Lafferrère. L’idée est d’utiliser cette dynamique pour collaborer sur des sujets très précis, identifier des verrous et lever des freins que rencontrent de nombreux acteurs de la filière. Il cite en exemple la réglementation française sur les MOT (micro-organismes et toxines hautement pathogènes), qui entraîne des mois de délais pour obtenir des autorisations quand cela prend trois semaines dans d’autres pays. Des discussions sont en cours avec les autorités et l’AIS pour tenter d’améliorer les processus tout en conservant les exigences de sécurité. Sur des sujets comme le passage à l’échelle, « on gagnerait à travailler davantage avec les autres filières biotech hors santé », suggère Anne Jouvenceau.
Des atouts d’attractivité à faire connaître
Si la France « manque d’audace » et de CDMO d’envergure, elle dispose malgré tout, selon Emmanuel Gaud, de certains atouts pour la bioproduction : « un terreau fertile, de très belles formations académiques, des sociétés et équipementiers de talent », énumère-t-il. Mais pour Anne Jouvenceau, la formation mérite un effort particulier, car « l’innovation sans compétence est non durable. » D’où le lancement d’appels à manifestation d’intérêt « Compétences et métiers d’avenir » dans toutes les filières. « Beaucoup d’entreprises ont encore du mal à attirer des talents, observe-t-elle. Il faut rendre visibles les outils de formation dont on dispose et les mailler avec les autres acteurs. »
De son côté, Mathieu Losguardi, directeur financier de WhiteLab Genomics, trouve « plutôt facile » de recruter des talents. « Les personnes qui font carrière dans les sciences du vivant sont des créatifs qui veulent casser les codes. Dans un monde où les frontières se referment et les esprits se rétrécissent, la France et l’Europe, de par leurs valeurs, sont attractives. Nous sommes une société franco-américaine, mais toutes nos opérations de recherche sont en France ! » « Attractivité est un terme décisif, mais comment rendre la France attractive si on ne fait que se plaindre ? Il faut être optimiste et rendre la filière désirable pour attirer les jeunes vers nos métiers, les industriels en France et les capitaux vers nos projets », insiste Laurent Lafferrère.
La question du financement est aussi cruciale. « On constate aujourd’hui une forte frilosité des investisseurs, qui demandent aux biotechs des projets de plus en plus dérisqués », analyse Anne Jouvenceau. Cependant « beaucoup d’acteurs du capital-risque classique commencent à tenir un autre discours et se disent prêts à vous financer sur deux-trois ans à perte, si vous arrivez à prouver sur douze mois que votre modèle est rentable : c’est une vraie bonne nouvelle pour les sociétés de bioproduction ! », estime Mathieu Losguardi. « La France a-t-elle les poches assez profondes ou faut-il passer au niveau européen ? », s’interroge Laurent Lafferrère, qui rêve d’une filière plus résiliente à l’échelle du continent, où la compétition ne serait plus entre la France et ses voisins, mais entre l’Europe, la Chine et les Etats-Unis.
Julie Wierzbicki
(1) Evènement organisé en partenariat avec PariSantéCampus et avec le soutien de Benta Lyon, Mayoly et le Sicos (syndicat de l’industrie chimique organique de synthèse et de la biochimie)
REPLAY DISPONIBLE ICI