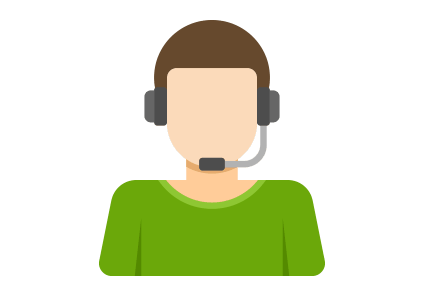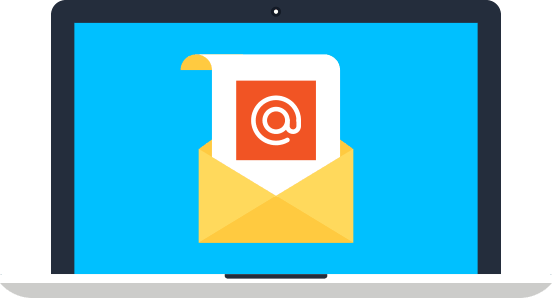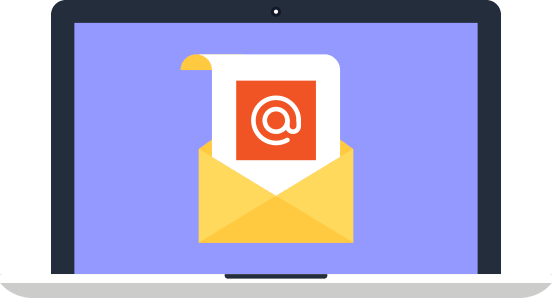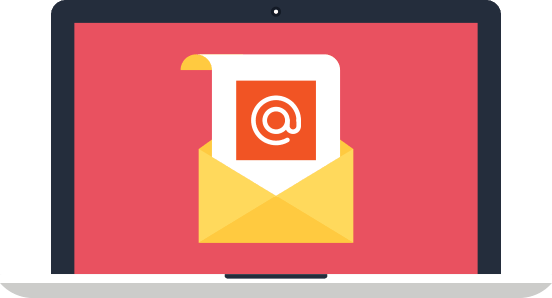Pour une nouvelle politique de prix du médicament qui intègre sa valeur sociétale
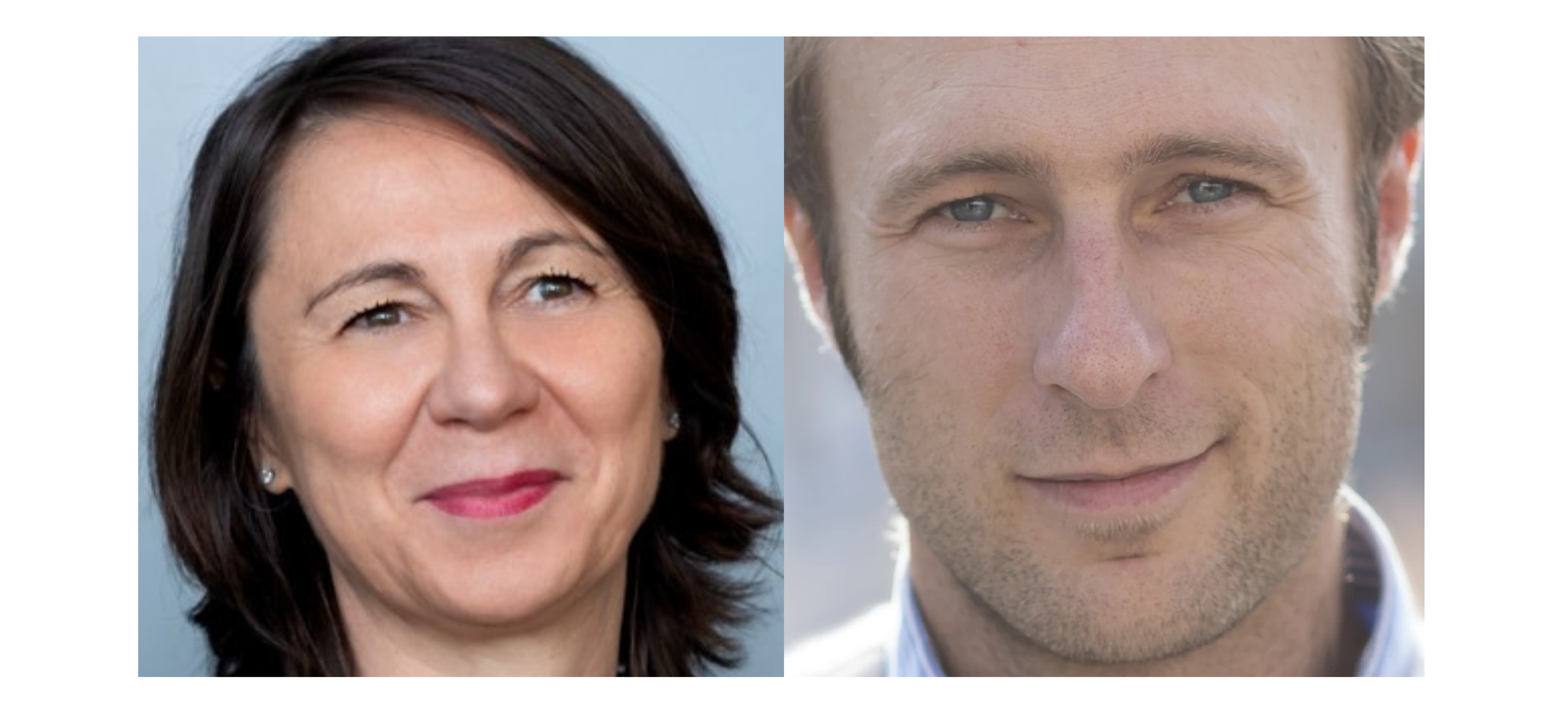
Par Nathalie Gimenes, docteure en sciences de gestion, Mines Paris-PSL, présidente de BE-CONCERNED et Martin Blachier, médecin de santé publique, co-président de Public Health Expertise
Le 26 juin 2025, François Bayrou appelait, dans une lettre adressée à la présidente du CEPS, à bâtir « une véritable stratégie industrielle de santé » en vue du PLFSS 2026. Cette ambition suppose de repenser les mécanismes de fixation des prix des médicaments largement guidés par une logique de maîtrise budgétaire.
Les limites du paiement à la performance
Aujourd’hui, deux critères principaux fondent l’appréciation de la valeur d’un médicament : son service médical rendu (SMR) qui fixe le niveau de remboursement, et son amélioration du service médical rendu (ASMR) qui sert de base à la négociation du prix. Ce dernier est également influencé par la comparaison avec des traitements équivalents, la population cible et les prix pratiqués à l’étranger. En revanche, les bénéfices élargis que peuvent apporter certains traitements pour la collectivité, sont encore rarement intégrés, alors même qu’ils devraient contribuer à fonder la légitimité de l’engagement de la solidarité nationale dans leur prise en charge. Depuis plusieurs années, le modèle du value-based healthcare ou paiement à la performance qui associe la rémunération des industriels aux résultats cliniques observés en vie réelle, propose en théorie un cadre plus efficient orienté vers la valeur. Mais sa mise en œuvre se heurte à de nombreux obstacles : coûts élevés de suivi en vie réelle, complexité de la mesure des résultats, hétérogénéité des pratiques, acceptabilité limitée parmi les soignants et risque de contentieux entre les parties prenantes. À ce jour, en France comme dans les pays européens, ce modèle reste plus théorique qu’opérationnel.
La valeur sociétale, un levier de la soutenabilité du système de santé
Face à ces limites, une alternative plus pragmatique mérite d’être explorée : l’intégration explicite de la valeur sociétale dans les critères de fixation des prix des médicaments. La valeur sociétale rend compte de manière objectivée de la contribution de certains traitements au bon fonctionnement du système de santé et à des objectifs collectifs partagés : réduction des hospitalisations, amélioration de la prévention et de la qualité de vie, optimisation des parcours, diminution de l’empreinte carbone, développement de l’accès aux soins dans les territoires fragiles, ou encore contribution à des démarches de relocalisation industrielle ou d’économie circulaire. Ces bénéfices et externalités positives, encore peu intégrés dans les outils d’évaluation existants, participent pourtant de la soutenabilité du système de santé et du développement d’une industrie pharmaceutique résiliente, verte et ancrée dans les territoires. La valeur sociétale d’un traitement permettrait ainsi de mieux refléter l’utilité globale d’une prise en charge y compris dans des logiques d’enveloppes budgétaires qui en faciliteraient l’intégration dans les circuits de régulation actuels. Elle constituerait ainsi une réponse à la fois opérationnelle et stratégique aux attentes croissantes des acteurs publics, tout en valorisant les efforts en matière de RSE et d’innovations responsables portés par les entreprises du médicament.
Le rôle central de la CEESP
Cette évolution ne requiert pas une transformation institutionnelle majeure. Elle peut s’appuyer sur l’expertise existante de la Commission d’évaluation économique et de santé publique (CEESP) dont la vocation est précisément de produire des analyses médico-économiques et systémiques. La CEESP pourrait ainsi jouer un rôle central dans l’opérationnalisation de cette nouvelle approche de la valeur, en intégrant dans ses évaluations des co-bénéfices sanitaires, sociaux, territoriaux et environnementaux. Au-delà de la seule régulation des prix, cette redéfinition de la valeur contribuerait à la production de données d’impact sociétal, directement exploitables par l’ensemble des parties prenantes – industriels, professionnels de santé, décideurs publics, acteurs territoriaux. Ces indicateurs alimenteraient une dynamique d’innovation responsable, orientée vers l’intérêt général et la soutenabilité à long terme du système de santé.